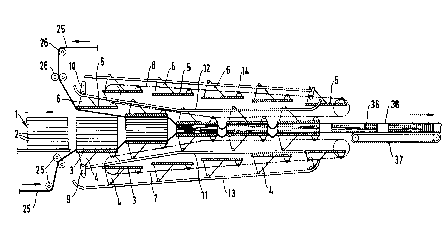Note: Descriptions are shown in the official language in which they were submitted.
CA 02219636 1997-10-27
WO 96l36536 PCT/FR96/00693
PROCEDE ET DISPOSITIF DE COMPRESSION
5ET D'EMBALLAGE DE PRODUITS COMPRESSIBLES
L'invention concerne les techniques de co~ rcssion et d'emh~ ge de m~t~?ri~llx
colllpressibles tels not~mment que des ensembles de p~nn~iqllx de fibres minérales.
Pour transporter et stocker à moindre frais des produits volllminellx mais
10 compressibles et susceptibles de retrouver leur volume et toutes leurs caractéristiques
d'origine après leur libération, il faut disposer de techniques et de m~.hin.o~ adaptées. Elles
doivent permettre d'obtenir rapiclement et automatiquement une coll~les~ion efficace et un
emballage de qualité tout en préservant les caractéristiques des produits concernés.
Le brevet des Etats-Unis US 4 501 107 décrit une m~t~.hine destinée à empiler des
1 5 m~t~1~e de laine min~r~le puis à les c~ .,;",er pour les introduire à l'état colllplilllé dans
une sorte de sac qui co~lilue l'emh~ ge du produit. Ils y demeurent pendant le transport
et le stockage jusqu'à leur arrivée sur le chantier où en coupant l'enveloppe, on libère les
m~tel~.~ qui reprerment leur ép~i~sellr d'origine.
Ce document US 4 501 107 fournit des moyens automatiques pour réunir en pile les20 m~t~ , pour c~,lll., ;",er la pile, puis pour introduire la pile c~,",l., ;~"~e. dans un sac où elle
reste à l'état com~lilllé. Le moyen de colll~les~,ion est une plaque placée sur le dessus de la
pile et animée grâce à un piston d'un mouvement vertical vers le bas, tandis que la plaque
sur laquelle repose la pile reste, elle, immobile.
La méthode décrite dans ce document est efficace mais elle présente l inconvénient
25 de toute méthode discontinue, celui des temps morts qui séparent la fin d'une opération
d'en~rh~ge du début de l'opération suivante. Par ailleurs, I'introduction de la pile
co,ll~-lhllée dans le sac ne peut se faire sans employer des accessoires (essentiellement deux
plaques, au-dessous et au-dessus de la pile) pour m~int~nir la pression pendant
l'introduction, accessoires qui occupent une place non négligeable dans l'emballage et qui
30 autorisent par conséquent une décompression importante lors de leur évacuation. De plus,
l'introduction se faisant dans les sacs par poussée arrière, il y a frottement des bords de la
.pile comprimée contre des tôles fixes et risque de détériorer les p~nne~llx.
CA 02219636 1997-10-27
W 096/36536 PCTnFR96/00693
Le brevet des Etats-Unis US 3 717 973 décrit, lui, une m~rhine pour colllpl;l.ler en
continu des volumes de produits colllplesaibles~ en particulier des rouleaux de laine
minérale, pour les introduire sous forme parallélépipédique, dans une gaine de Aimen~ion
supérieure où ils restent à l'état comprimé (mais moins qu'au moment de leur
5 introduction). Le dispositif décrit comporte en partie inférieure un transporteur à bande
sensiblement ho~;~c.,.l;tl et en partie supérieure, un transporteur synchrone qui est en deux
parties planes succes~ives, la première co~lv~lgel,le par rapport au tapis inférieur et la
seconde qui lui est sensiblement parallèle. A la sortie de cette ~lellxième zone, deux
nouveaux transporteurs à bande ho~;~(.-.l1.-x font pénétrer le produit qu'ils ont m~intrn
10 c-)l;é dans l'emballage en forme de gaine.
Bien que l'opération de cc lllpl~;SaiOn s'effectue de manière continue, l'emh~ ge en
bout de ligne est une opération qui est, elle, discontinue et nécessite l'illl~ ;llLion d'un
op~;ldL~u-. Par ailleurs, comme dans la méthode discontinue de US 4 501 107, le m;~xi~
de colll~lcsaiOn qui a été obtenu à la fin de l'opération de colllpleaaion n'est pas conservé
dans l'emh~ ge car ici aussi des tapis roulants qui ont pénétré dans la gaine doivent en
être extraits à la fin de l'opération.
Le doc-lment DE-A-26 01 590 décrit une méthode pour emballer des paquets
allongés con~ti~és en particulier de rouleaux de tissus. Le procédé est continu; tandis que
les paquets placés en long sur un Lldlla~ull~ul sont entrâînés par lui, on dépose au-dessus
un film d'emh~ ge dont la largeur est telle qu'à lui seul, il peut ell~ul." le paquet. Le
trana~,.L~u est en deux parties, chacune supportant un côté du paquet. Entre les deux
parties, au-dessous, est installé un dispositif de soudure qui permet de former une gaine
autour du paquet.
Le document DE-A-26 01 S90 prévoit également qu'entre deux paquets qui se
s--rcèArnt un dispositif adapté puisse souder les feuilles d'emballage et les couper pour
rendre leur autonomie aux paquets.
L'invention se donne pour tâche de fournir un procédé qui permette de comprimer
efficacement en continu des volumes de produits co~ aaibles, notamment des
empilements de matelas de laine minérale.
Pour atteindre cet objectif, l'invention propose un procédé de conditionnement d-un
volume de m~trri~ll col.4,leaaible dans lequel le volume est placé entre deux surfaces de
pressage et transporté latéralement par rapport à la direction de pressage tandis que les
surfaces se rapprochent l'une de l'autre et dans lequel les surfaces sont des plans parallèles.
CA 02219636 1997-10-27
W 096/36536 PCTA~R96/00693
Cette disposition permet d'éviter de solliciter le volume en ci~zlillement pendant
qu'on le co..~l,.;...e. La technique connue de c(,l-lplcs~ion continue pendant le transport du
produit comme par exemple celle de US-A-3 717 973 co--l~fil--e en effet davantage l'avant
du volume que l'arrière, ce qui provoque un effort de cisaillement préjudiciable au produit.
5 Dans le cas de m~tel~ de laine minér~le en particulier, cette technique aboutissait à des
u~Lu es de fibres, ce qui faisait que le produit ne retrouvait jamais complètement après
rel~chement de la cc~ s~ion, son élasticité d'origine.
La technique doit également permettre une action rapide et qui ne détériore pas les
propriétés élastiques du m:lteri~
L'invention propose que les surfaces de pressage soient celles de plaques portées
par des chariots associés deux à deux et que chacun des chariots soit associé à un chariot
qui le précède et à un autre qui le suit, pour constituer deux trains animés d'une vitesse
con~t~nte
De plc;r~ lce~ les surfaces de pressage se rapprochent de manière symétrique par15 rapport au volume de m~téri~ll colll~re~ible.
De manière in~tten~ e~ le fait d'exercer un effort symétrique sur le volume à
co...l";,..er permet de travailler plus r~piclement et de le faire en exerçant des efforts plus
réduits.
Bien entt-n~lll à la fin du pressage, le volume de m~teri~ll co---~l~ssé est enveloppé
20 dans une gaine qui limite son ~xr~n~ion, mais, comme c'est également une mission de
l'invention de garder au produit cnmprime emballé le volume m;~;"~lllll qu'il a atteint lors
de sa compression, le procédé de l'invention prévoit que la gaine soit constituée de deux
bandes d'un film d'emb~ ge placées au-dessus et au-dessous du volume de matériau,
qu'elles soient entrâînées avec lui, que leur largeur leur permette de se recouvrir sur les
25 côtés du volume colnl";",é et qu'elles soient liées l'une à l'autre sur lesdits côtés du
volume. De préférence, le film d'emk~ ge est un film plastique, les bandes sont liées par
soudure sans changer de plan et, après assemblage, la soudure est sollicitée en cisaillement.
Cette technique de formation de la gaine in situ, directement sur les volumes dematériaux, au moment où la co-~lp~es~ion est m~xim~le garantit que le volume ne changera
30 pas sur le produit emballé.
Pour mettre en oeuvre le procédé, l'invention propose un dispositif comportant
deux transporteurs convergents situés l'un au-dessus de l'autre et animés d une vitesse
con~t~nte, ils culllpulLellL des chariots support~nt des plaques planes, parallèles à un même
CA 02219636 1997-10-27
W O 96/36536 PCTA~R96/00693
plan, qu'ils entr~înent, les plaques d'un transporteur et de l'autre étant superposées. De
cllce, les plaques planes collc~ n-l~ntes sur un tran~ollt;ul et sur l'autre sont
symétriques par rapport à un plan qui leur est parallèle.
Pour constituer la gaine, le dispositif de l'invention comporte associé à chaque5 transporteur un distributeur d'une bande de film plastique disposé de manière à mettre une
bande en contact avec la plaque du premier chariot inférieur et une autre en contact avec
celle du premier chariot supérieur, par ailleurs, les bandes de film plastique ont une largeur
leur permettant de se ~u~cl~oser sur les côtés des volumes de m~teri~ll colll~l;.l.é. De
plcr~lcllce, les transporteurs collvcl~clll~ COlll~Ol~tll~, en aval, une zone où l'écart entre
10 plaques col.c~ ntes est sensiblement invariable. Le dispositif cOlllpOl~c, not~mment
dans cette zone, des éléments conform~tellrs ~lestin~s à placer les bords des bandes de film
plastique superposées, à plat sur les côtés des volumes de m~t~ri~ll col.lpl;...é ainsi que, en
aval des éléments conformateurs, des moyens pour réaliser la soudure des bords des bandes
de film plastique tels que des buses à air chaud.
1 5 Ainsi, le dispositif permet de bloquer l'objet cc,.. lples~ible à son volume le plus bas
qu'il pourra pratiquement garder pendant son transport et son stockage. Il ne retrouvera une
possibilité d'extension que lorsqu'on coupera la gaine en film plastique, sur le chantier. Et
à ce moment, grâce à la technique originale de c~....l)rc~ion de l'invention, il retrouvera
son volume de départ et, surtout, toute son él~ticite.
La description et les figures permettront de comprendre l'invention et d'en
percevoir les avantages. Parmi les figures,
la figure 1 montre une vue globale d'une m~rhine selon l'invention,
la figure 2 représente l'c2~ -liLc amont de la m~hine lors de la mise en circuitd'un nouveau chariot,
la figure 3 montre à l'~ cllli~c aval, la sortie d'un chariot du circuit et
la figure 4 montre une variante selon laquelle, les chariots se déplacent comme les
marches d'un escalier roulant,
la figure 5 représente les conformateurs des bords des bandes de film d'emballage
et une buse à air chaud.
La figure 1 lc~rcs~ c une ligne de conditionnement de volumes d'un matériau
colllplcs~ible, en l'occurence une pile 1 de p~"i~e~.lx 2 de fibres minérales au nombre de 8
ici. Il s'agit de co---~lhller cette pile et de la conditionner (l'emballer) sans qu'elle reprenne
de volume.
CA 022l9636 l997-l0-27
W O 96/36536 PCTA~R96/00693
A son arrivée à l'entrée de la m~ in~, la pile est déposée sur un plateau hol;~onL~l
fait d'une plaque 3. De ~ler~;lellce, la pla~7.Le est rectangulaire comme les p~nne~llx et la
pile est centrée sur la plaque. Elle va rester sur cette plaque 3 jusqu'à sa sortie de la ligne
de conditionnement
Dans ce qui suit, on décrira succescivement l'opération de compression seule puis
l'opération d'emballage.
La plaque 3 est supportée, comme les neuf autres plaques inférieures et comme les
10 plaques supérieures l~res~ Pes, par un chariot 4. En effet, au-dessus de la pile 1 se
trouve une autre plaque 5 identique et parallèle à la plaque 3 et ~u~ulL~e comme elle par
10 un chariot 6. Les deux chariots 4, 6 avancent de manière synchrone en se rapprochant l'un
de l'autre. Ils sont entr~înés chacun par une châîne 7, 8 (ou deux ch~înes, une de chaque
côté du chariot). Les cinq chariots inférieurs et les cinq chariots supérieurs qui participent
au pressage du volume 1 conctit lent un train qui avance régulièrement, entrâîné par les
châînes 7, 8.
Pendant l'opération de colllpl~;s~ion, les chariots 4, 6 sont tirés par les chaînes 7, 8
auxquelles ils sont liés par des axes passant chacun dans le creux d'un maillon de la châîne
tandis qu'un galet lisse centré sur l'axe permet de guider la chaîne. A l'arrière du chariot,
de chaque côté sont prévus de moyens de guidage sous la forme de galets 9, 10 qui suivent
un guide 11, 12 (un rail). Les trajets suivis par les châînes 7, 8 et par les guides 11, 12 sont
20 tels que lors de la progression des chariots 4, 6, les plaques 3, 5 restent sensiblement
hol;:~",l;llec tout en pro~lc;ss~ulL l'une vers l'autre. Il pourrait se faire cependant que pour
une raison ou une autre les plaques 3, 5 soient inclin~ec par rapport à l'horizontale.
L'important est qu'elles soient toujours aussi parallèles que possible et qu'il ne se produise
pas de glissement entre les plaques et le m~teri~ qu'elles comprim~nt
Sur la figure, on a représenté une trajectoire rectilipne pour les chaînes 7, 8 comme
pour les galets arrière des chariots 9, 10 mais il peut être intéressant d'avoir une pente
dirr~ ;llte selon les phases du processus de co...p.~;s~ion.
A la fin de la co...p.~;s~ion (qui concerne sur la figure deux chariots en bas et deux
en haut) le matériau co...plilllé est transporté sans changement de volume.
Au bout de la ligne de conditionnement, les chariots sont extraits de la trajectoire
qu'ils suivaient pendant la compression et repartent dans l autre sens, poussés par les
châînes et guidés par une deuxième partie de guide 13 au-dessous des guides 11 et 14 au-
dessus du guide 12.
CA 02219636 1997-10-27
W 096/36536 PcT/~3Gl~cg3
Pour passer d'une partie de guide 11, 12 à une autre 13, 14, il faut manoeuvrer des
aiguillages. La figure 2 représente l'aiguillage arnont et la figure 3, l'aiguillage aval (dans
les ceux cas, il s'agit du chariot inférieur, les dispositifs pour les chariots supérieurs sont
équivalents).
Sur la figure 2a, le galet 15 doit quitter la partie de guide inférieure 13 pourrejoindre la partie de guide supérieure 11 avant de commencer l'opération de compression.
A i'autre ~Llc;lllil~ du chariot, i'axe i6 iié au chariot est çntr~ïne par ie maiiion de ia
chaîne 7 qu'il traverse.
Entre la partie de guide inférieure 13 et la partie de guide supérieure 1 1 se trouve un
élément de guide mobile 17. Il est capable de coulisser latér~lement dans le prolongement
de la partie de guide supérieure 11. Quand le chariot arrive (figure 2a), il est en position
vers la droite, mais quand le chariot repart (figure 2b), il est situé en butée à gauche Il va
se déplacer de nouveau vers la droite pendant la progression du chariot de manière que,
lorsque le galet 15 arrive dans la zone de raccordement 18, le guide mobile 17 y soit en
1 5 place pour éviter toute disc~
Le déplacemeht du guide mobile 17 peut être effectué par un vérin comm~n~1e par
un or~lin~tel-r central chargé de comm~n-ler l'ensemble de la ligne de conditionnement. Il
est cependant préférable d'avoir un entr~înement ~ positif ~ de l'élément de guide mobile
17 par la roue à dents 19 qui entraîne et/ou supporte la châîne 7. Cette liaison mécanique
est réalisée par un système bielle-manivelle non ~ C,S~lllt.
Sur la figure 3, le système est dirr~ ,.ll car l'élément de guide mobile 20 se déplace
en tllLl~îll~l~ avec lui le galet 21 qui passe ainsi presque in~t~nt~nément de la partie de
guide supérieure 11 à la partie de guide inférieure (de retour) 13 Le transfert s'effectue
pendant que la roue dentée 22 support (et éventuellement entr~înement) de la chaîne 7
effectue un demi-tour La bielle 23, en position rétractée sur la figure 3a agit pendant la
rotation de la roue dentée 22 sur l'élément 20 qui tourne autour de son axe 24 et vient
mettre (figure 3b) l'élément de guide mobile 20 vis-à-vis de la partie de guide inférieur 13
lorsque la bielle 23 est en extension.
Les deux systèmes représentés sur les figures 2 et 3 permettent de gagner de la
place mais il serait également possible d'avoir un rail continu qui soit suivi par les galets 9,
10, 1~, 21. Dans ce cas, des dispositifs sont cependant à prévoir pour éviter, en partie
gauche en bas ou en partie droite en haut, que le chariot, entraîné par son poids en bout de
CA 02219636 1997-10-27
W O 96/36536 PCTAFR96/OOG93
course, ne reparte dans la direction d'où il vient. Ce peut être par exemple une chaîne qui
entrâîne les galets 15, 21 analogue aux châînes 7, 8.
La figure 4 représente une variante du système d'entrâînement des plateaux qui ont
pour fonction de transporter et de presser les volumes de m~téri~nx co~ ressibles. Ce
5 système, traditionnel dont le méc~ni~me s'a~ t; à celui des escaliers roulants, présente
l'inconvénient de néces~iL~;l un espace beaucoup plus hllpull~ll pour le circuit de retour.
Par ailleurs, au moment où les plateaux doivent s'écarter pour libérer les produits
colll~filllés, ils ne peuvent rester ni parallèles ni hufi~;ollL~ux ce qui ne facilite pas la
m~ e..lion des produits tçrminés. Des solutions mixtes sont également possibles, l'une
10 des faces des piles de p~nne~llx étant ~u~oll~e (ou surmontée) par une plaque associée à
un chariot tandis que l'autre est en appui sur un unique tapis l~ ~oll~ul synchrone de
manière à éviter les gli~sçment~ Mais dans ce cas, le procédé d'emb~ ge ne pourrait être
celui décrit plus loin, il doit être adapté.
Le procédé de l'invention inclue également une technique d'emh~ ge originale.
Elle est ici appliquée à un volume de m~téri~n c.. l.,;.. é mais est applicable également à
des produits dont la masse volumique ne ~limimle pas lors de leur conditionn~-nnent Dans le
cas des produits colllpl~ ibles -co~p~ éc de l'invention, la technique d'emb~ gedécrite plus loin ou une technique équivalente est un complément indispensable de la
méthode de colll~lession car elle seule permet de conserver pratiquement le volume
20 co...p. ;.--é en lhlliL~ll au m~xhllulll la reprise de volume.
Sur la figure 1 et sur la figure 4 est représenté un système d'~liment~tion en film
d'emh~ ge 25. Le film est issu de deux rouleaux non représentés. Il possède une largeur
précise qui au cours des essais était pour chacun des films 25 égale à la moitié du périmètre
du volume cû-, 'l" ;...é ~lgmentée de quelques centimètres pour permettre un recouvrement
des films consLiLu~lL chacun, la moitié de la gaine qui emballe et emprisonne le produit
comprimé.
Le choix de deux demi-gaines de largeur identiques est ~biLdil~. Il permet de faire
~ la jonction des deux films au milieu des côtés des volumes comprimés mais on aurait pu
aussi bien choisir des largeurs dirr~ lLes ou des positions dissymétriques pour les films
d'emballage et donc, des emplacements de jonction placés différemment
Les films 25 sont guidés par des rouleaux 26 de manière à entrer en contact
respectivement avec les plateaux 3, 5 des premiers chariots 4, 6. Sur la plaque inférieure 3,
le film d'emballage déborde latéralement des produits à colllp~ ler (et, même
CA 02219636 1997-10-27
W 096/36536 PCTA~R96/00693
éventuellement du plateau 3 lui-même). En partie haute, les bords de la bande se r~h~tt~nt
de chaque côté de la pile 1. L'entrâînement du film 25 se fait de pl~rélcllce uniquement par
le mouvement des chariots, ce qui assure que le film se tende lon~it l-1in~lement sous et sur
la pile 1 de m~tel~ 2 de fibres minérales. Sur la figure 1, les derniers chariots sont dans la
5 zone de colll~)lession, les deux premiers dans la zone d'emballage, là où la longueur de film
entre plaques ne varie plus, et le cinquième, au milieu, à la transition entre les deux zones.
Dès le début de la zone d'emballage, figure 5, on a placé dans la zone médiane, de
chaque côté, des conform~tellrs dont le rôle est de mettre en place les bords des bandes de
film 25. On voit sur la figure une plaque d'appui 27 sur laquelle le film supérieur vient
10 s'a~ yel (à l'extérieur) et qui s'étend jusqu'après la zone de jonction. Un conformateur
28, sorte de plaque mét~llique de forme adaptée, vient plier la bordure du film supérieur 34
qu'un rouleau ~ t;U~ 29 vient appliquer sur la plaque d'appui 27.
De manière symétrique, la bordure du film inférieur 35 est prise par le collrollllateur
31 et conduite le long de la plaque d'appui 30 (située à une distance définie de la plaque
d'appui 27) où elle est pressée par le rouleau 32. Au bout de la plaque 30, les deux
bordures, supérieure et inférieure, viennent en contact et l'on peut réaliser leur
solicl~ri~tion. Pour effectuer celle-ci, plusieurs moyens 33 sont possibles, apport d'une
colle extérieure (hot melt not~mment), dépôt d'un adhésif double face qu'on aura introduit
à l'extrémité amont de la plaque d'appui 30 du film inférieur, ou alors soudure autogène de
films plastiques adaptés. C'est cette technique qui constitue le mode de réalisation préféré
de l'invention. Le film est un film de polyéthylène HD (haute densité) d'une ép~ ellr de
50 à 100 ~m (des essais faits avec un film BD basse densité ont également donné
d'excellents résultats), le moyen pour réaliser la fusion de la matière est la chaleur apportée
par des buses qui soufflent un air à une température comprise entre 400 et 650~C; les
essais ont été réalisés avec des chauffe-air de la Société LEISTER. L'homme du métier
adapte ~elll~ld~u-e d'air et vitesse de soufflage à la vitesse de déplacement du film devant
les buses. Par ailleurs, des sécurités coupent l'arrivée d'air chaud (ou le dévient) en cas
d'arrêt de la ligne. ~
La technique d'çmh~ ge qui vient d'être décrite en détail utilise une technique de
soudure autogène d'un film plastique, on ne sortirait pas du cadre de l invention en
tili~nt un film d'emballage d'une autre nature ou une technique de jonction des bords du
film différente.
CA 02219636 1997-10-27
W O 96/36536 PcT/~9G~Qoc93
De même, le moyen d'assemblage des bordures des deux bandes supérieure et
inférieure qui se croisent et se recouvrent sur une surface importante - pourrait être
remplacée par une jonction bord à bord, où la face interne d'un film serait en contact avec
la face interne de l'autre. Cette technique n'est pas la p,~r~ c car elle sollicite la soudure
ou la jonction collée en pelage, et ce type d'assemblage est moins solide que celui qui a été
retenu où le joint est sollicité en cisaillement.
L'utilisation d'un film résistant et à haut module, c'est à dire qui ne s'allonge que
très peu sous charge permet de garder à un volume de matériaux co~ l;lllés comme une
pile de m~t~ de fibres minér~les la taille Illil)illllllll possible qui s'écarte peu de la taille
1 0 qu'il a atteinte à la fin de la cc~ s~ion, l'effet de la libération hors des plateaux tels que
3, S étant ~implement une déformation du périmètre de la gaine qui s'arrondit sensiblement
en accroissant son épaisseur dans l'axe et en s'~minci.~ nt sur les bords tandis que sa
surface et donc le volume du produit co,-~ ;",e s'accroît légèrement.
A la sortie de la ligne, les paquets de matériaux emballés 36 sont entraînés par un
1 5 transporteur 37. Ils sont associës en chapelet dans la gaine d'emballage. Entre deux
paquets, la ~ se ~ cQm~e u~ bQy~ Yide~ 38 D~ une v~riante de l~inve-n-tion~
on a prévu d'installer à ce niveau un dispositif connu qui permet de souder et/ou de couper
automatiquement les films pour donner aux paquets de matériaux emballés leur autonomie
et éventuellement les protéger si l'on ferme l'emballage.
Les essais réalisés avec la m~rhin~. qui vient d'être décrite pour colll~lhller et
conditionner des m~t~l~c de laine minérale ont été très positifs.
On a fait une série de piles de 8 matelas de laine de verre d'une ~1imen.~ ion de 1200
x 600 mm, l'ép~i~se~lr des matelas était 128 mm et leur masse volumique 7 kg/m3. On a
mesuré une hauteur de pile avant conl~ sion de 1010 mm (légère compression sous
l'effet du poids). Les piles identiques se suivaient normalement sur la ligne.
La partie supérieure de la machine qui peut être déplacée verticalement ayant été
placée de manière à ce qu'en bout de ligne, les plateaux soient distants de 125 mm. On a
effectué une mesure de la force exercée, elle était de 206 décanewtons.
Le film d'emballage était un polyéthylène HD de 60 ~lm d'épaisseur, la vitesse
d'avancement de la ligne était de 20 m/min. A la fin du cycle compression-emballage-
soudure transversale- séparation des paquets, on a mesuré le volume des paquets. Il était de
112,5 litres, ce qui correspond à un taux de compression de l?ordre de 6,5. Lors de la
CA 022l9636 l997-l0-27
W 096/36536 PCTA~R96/00693
libération de son enveloppe, la pile de produits a retrouvé une hauteur de 950 mm, ce qui
colle~ond à une perte d'épaisseur par p~nne~qll, acceptable.
Une seconde série d'essais a été effectuée. Il s'agissait de colllplilller et deconditionner des p~nne~n~ de laine de verre d'une llimen~ion de 1350 x 600 mm avec une
ép~i~se~-r nominale de 100 mm (108 mm d'épaisseur réelle). Leur masse volumique était
13,75 Kg/m3.
On a successivement réalisé des piles de 7, 9, 11 et 15 p~nne~ et l'on a co"~p~ ,",é
chaque pile davantage que la précé~ente Le tableau ci-dessous présente les résultats.
Nombre de p~nne~ln~ 7 9 11 15
Ep~i~senrdelapile(mm) 740 945 1145 1545
Distance finale entre plaques 160 169 166 200
(mm)
Coll~rei,~ion m~xim~le 4,6/1 5,6/16,9/1 7,5/1
Fp~i~seurhorstoutdu 318 320 325 350
paquet conditionné (mm)
Taux de colll~lcs~ion 3,1/1 3,9/14,7/1 5,6/1
A la fin de l'opération, après déchirure de la gaine, les p~nne~llx libérés ont
1 O retrouvé leur ép~i~sel-r nominale, 100 mm.
La méthode de colll~l-,s~ion et de conditionnement des essais précédents permet
ainsi de disposer d'un produit emballé dont le taux de colllpl~ssion est le m~ximllm qu'il
est possible de conserver avec comme emhall~ge, une gaine déformable.
Les techniques de l'invention qui viennent d'être décrites permettent ainsi de
1 5 conditionner et d'emballer facilement des volumes de m~téri~llx colllples~ibles et
not~nnment des piles ou des rouleaux de laine minérale. A la différence des procédés
antérieurs, l'emballage se fait en continu et la culllp~ ion qui s'effectue simultanément et
symétriquement sur le volume évite les dégradations dues au cisaillement de la matière et
permet d'opérer plus vite avec des efforts moindres.